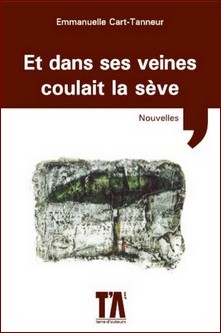Tu ne m’avais pas prévenu.
Tu ne m’avais pas dit qu’un jour tu ne m’aimerais plus. Que je ne serais plus la moitié de notre tout. Que tu ne te rappellerais même pas pourquoi, un jour, tu m’avais dit Oui.
J’aurais dû me douter que ce jour arriverait ; mais j’en ai refusé l’idée, même lorsqu’elle est devenue évidence, car moi, sans toi, je n’étais plus rien.
Je t’envierais presque, tu sais : tu sais où tu vas, même si tu ne sais pas vraiment pourquoi – ça, tu ne le dis pas, mais je le sais, moi.
Moi, j’ai voulu croire en nous, encore, même après les heurts qui se sont multipliés et que je n’ai voulu prendre que pour les péripéties inévitables d’un amour comme les autres ; et pourtant j’affirmais, dans le même temps, que nous, ce n’était pas comme les autres.
Mais tu m’as rejeté. Tu as refusé toutes mes tentatives de rapprochement, toutes mes demandes d’explication ; ricané devant mes lettres, méprisé mes maladresses, haussé les épaules devant mes serments : j’allais changer, me plier à tes désirs, devenir l’idéal que tu me reprochais de ne pas être.
Je serais devenu qui tu voulais.
Mais tu ne voulais plus de moi, qui que je sois.
Alors, voilà.
Voilà cette lettre écrite de ma main, que je poserai en évidence sur le buffet, pour qu’elle soit la première chose que tu voies en rentrant ce soir.
En fait, je crois que ce n’est pas ce que tu verras en premier.
Tu te demanderas ce qui est arrivé au buffet ; pourquoi il est coupé en deux par le milieu, éventré comme un blessé agonisant, tripes à l’air, sur le champ de bataille.
Pourtant, je n’ai fait qu’obéir à tes souhaits : partir, après avoir partagé ce qui nous avait unis. La moitié de tout, c’est ce que tu m’as demandé de te laisser. Grande seigneure, tu n’as pas voulu préciser ce que tu tenais à garder : Fais comme tu veux, m’as-tu lancé. Prends ta part, et fous le camp.
Ma part, je ne la prendrai pas ; je ne veux aucun souvenir de ces ruines qui furent le décor d’un passé que j’ai cru heureux. Je te la laisse, ma moitié. Je vais juste la délimiter, la marquer, que tu saches bien que je ne t’ai rien pris – que je n’emporte que ma détresse et ma colère. Entières, elles.
La porte ne sera pas fermée, viens demain, pendant que je serai au boulot, m’as-tu dit, laconiquement, par un message laissé hier sur mon répondeur.
Alors je suis venu. Je suis passé à Casto avant, et j’ai acheté cette tronçonneuse. Le vendeur m’a assuré qu’elle était hyper-puissante, capable de fendre l’acier, à l’en croire. On va voir ça.
Je lance le moteur qui rugit, envahissant le silence de l’appartement. Je me fais la main sur un tabouret de la cuisine : c’est du beurre. Les demi-cercles s’abattent de part et d’autre, chacun pourvu de deux pieds dérisoires qui ne leur assurent plus l’équilibre. Les deux miens sont bien campés sur le sol quand j’attaque la table : la lame hurle tandis que les copeaux crépitent le long de la ligne de coupe – bien droite : je m’applique, et voici deux carrés de bois qui s’effondrent à leur tour sur le carrelage. La cafetière vole en éclats : non coupable. Dégât collatéral. Je ferai mieux avec les livres.
Tu les aimais, tes livres, que dis-je, tu les adorais. Et d’admirateur de ton intelligence, je suis passé victime de ta passion : la lecture est vite devenue la seule activité envisageable dans le lit conjugal Et voici que lit et livres se retrouvent, une fois ultime, réunis dans le même destin : je partage avec une égale jubilation tes piles de romans et le matelas qui garde la trace de nos étreintes . Les plumes voltigent dans la pièce, se déposant, indifférentes, sur les pages volantes et les couvertures déchirées.
Je n’entends plus le hurlement de l’engin ; je ne sens plus mes larmes couler ; je ne suis que bruit et fureur. Je sais que quand tout sera fini, je m’effondrerai. Alors, je continue.
Le Chesterfield de ta grand-mère était sûrement un faux : le cuir se déchire en lambeaux irréguliers là où j’aurais attendu une découpe digne d’un cordonnier. La lame a peut-être été émoussée par la chaîne hi-fi, dure à cuire, ou plutôt à scier – j’ai payé assez cher cet équipement de luxe l’hiver dernier, alors que je tentais encore de te retenir ; mais tu n’as jamais été mélomane. Tout juste si tu aurais distingué le souffle d’un hautbois du chant d’une clarinette. Le rugissement de ma tronçonneuse te sera bien suffisant en guise de chant de départ.
Meuble après meuble, je partage, je scinde, je sépare, j’écartèle. Moitié-moitié : ta part à gauche, la mienne à droite. Tu n’auras qu’à récupérer ce qui te revient, et balancer le reste aux chiens : je n’en veux pas.
Je suis en nage. J’ai presque fini. Un dernier geste de droite à gauche tranche les rideaux de velours horizontalement : je suis bon prince, je te laisse les anneaux. Le bas du tissu s’effondre mollement à terre dans un drapé de héros grec abattu.
Il ne reste plus rien à partager.
Ou presque.
Je regrette presque que tu ne sois pas là pour voir une dernière fois le regard fou du chat qui recule, devant mes pas, jusqu’à l’encoignure du salon.
Heureusement, finalement, qu’on n’a pas pu avoir d’enfant.