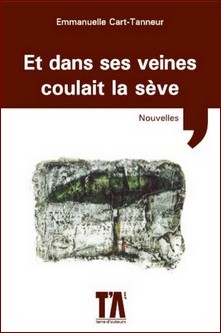Il fait chaud ce matin. Trop chaud, déjà.
Et puis cette blouse, ce vêtement rêche et réglementaire, m’étouffe et m’asphyxie, parfois plus encore que ce qui pousse en moi et qu’on voudrait chasser. C’est pour cela que je suis ici. À la maison, l’air est vicié, c’est ce qu’ils ont dit. Vicié, je ne connaissais pas le mot, mais maman m’a dit que je devais obéir, que c’était pour mon bien.
Pour faire oublier cette vilaine blouse, j’ai mis mon joli chapeau, celui avec le ruban rouge. Et mes bottes de peau. Maman a dit que c’était idiot, que j’allais avoir trop chaud, mais je ne l’ai pas écoutée, et elle a soupiré quand je les ai enfilées. Je crois que depuis que je suis malade, elle me laisse faire ce que je veux. Il faut toujours voir le bon côté des choses, c’est ce qu’elle disait tout le temps, avant, quand j’étais encore à la maison. La maison me manque, mais je n’ose pas lui dire que le jardin d’ici est cent fois plus beau ! Chaque matin, quand je me penche à ma fenêtre, c’est un véritable tableau que je redécouvre : terre-plein à l’arrondi parfait, comme issu d’un pinceau d’un artiste, pelouse lisse et dense, parsemée de trainées bleutées, grands arbres aux frondaisons vert sombre que la lumière anime en d’incessants mouvements… Je n’avais encore jamais vraiment fait attention à la beauté de la nature ; mais ici, on n’a que ça à faire : la regarder, la ressentir, s’en imprégner. Je me dis parfois que j’ai dû trop la respirer et que les bourgeons dans mes poumons, qui étaient encore petits, ont cru qu’ils devaient imiter ceux du dehors, et croître, se développer, prendre leur place pour aller chercher le soleil. Ils ne pouvaient pas savoir qu’on ne voulait pas d’eux ; que j’étais ici pour les faire mourir, pas pour les encourager. Ils ont dû se demander pourquoi on les bombardait de produits chimiques pendant qu’un jardinier s’occupait amoureusement du parc, chaque jour, une fenêtre plus bas.
Il fait si chaud ! Mais peu importe, moi, je cours.
Le vent s’engouffre dans ma camisole et mon corps frémit sous ses tièdes caresses. Que c’est bon ! Ce matin j’ai de la visite. Maman est là, accompagnée de ma tante Odette, qui d’ordinaire ne quitte jamais Paris. Elle a passé la journée dans le train pour venir te voir, a dit maman avant de me demander de l’embrasser. J’ai effleuré la joue piquante et remercié pour le ballon neuf de cuir beige qu’elle m’a tendu avec un sourire crispé. Un ballon neuf, n’est-il pas magnifique ? a insisté maman. Je n’aime pas bien Tante Odette, et je crois qu’elle ne m’aime pas non plus. Mais j’ai dit oui, et aussitôt j’ai filé profiter du soleil, les abandonnant à leur conversation – même si, je le sais bien, elles ne vont parler que de choses tristes. Que de moi, et de la maladie.
Je cours. Le cœur me serre, et le souffle me manque, mais je cours. Les bourgeons ont grossi, je les entendus en parler, mais j’ai feint la distraction. Je le savais. Comment pourrais-je ignorer ce qui se passe au fond de moi ?
Souvent, la nuit, je suffoque. Je reconnais maintenant la pression qui s’installe, l’air qui peine à trouver son chemin, et mes côtes qui se soulèvent à la recherche d’un souffle qui vient si mal. La sueur perle alors à mes tempes, et mes yeux grand ouverts ne savent plus que fixer l’horrible pendule qui fait face à mon lit : alors je compte, mes pensées s’accrochent à l’aiguille qui avance, et je halète, doucement, en domptant la panique que je garde à distance quand elle voudrait s’installer.
Puis la crise s’éloigne, et mon souffle reprend, peu à peu, un rythme régulier. Et chaque goulée d’air m’est plus délicieuse que le meilleur des sorbets. Alors j’oublie la pendule, et mon lit, et l’hôpital, et je me laisse emporter par le sommeil.
Maman me fait, de loin, un signe de la main, mais je ne lui réponds pas. J’ai joué un peu, le temps qu’elle s’éloigne avec ma tante, avec ce ballon beige aux coutures apparentes, bien trop lourd, que j’ai fini par abandonner derrière moi, se confondant déjà avec le sable de l’allée et qui, bientôt, s’y effacera, comme s’il n’avait jamais existé.
Je suis allée chercher ma balle rouge derrière le tas de bois. Celle que papa m’avait offerte. C’est là que je la cache, puisque je n’ai pas le droit de la monter dans ma chambre. Ma balle rouge est brillante, lisse et douce, et toujours prête à m’entraîner quand je la lance devant moi. On dirait que c’est elle qui me montre le chemin ; la semaine dernière, c’est à sa poursuite que j’ai découvert ce nid tombé de l’arbre, avec un œuf à peine fendu, et que j’ai replacé doucement sur une branche haute. Si l’on m’avait vue grimper, je me serais fait punir ! Mais j’y retournerai, pour voir si l’oisillon est né. Tout à l’heure, dès qu’elles seront parties. Seule. Juste moi, et ma balle rouge.
Le soleil monte dans le ciel et trace mon ombre devant moi. Je ris de la voir si bien m’obéir. Pied droit, pied droit. Bras gauche, bras gauche. Quel talent d’imitation ! Ma balle elle aussi a son ombre, mais c’est beaucoup plus facile pour elle qui ne fait que rouler. Maman et tante Odette, elles, n’en ont pas. Elles sont dedans. Comment peut-on préférer cela à la chaleur et au vent ? Vouloir s’en abriter, comme d’une brûlure ou d’une menace ?
Sur le sable de l’allée, les ombres des feuillages dessinent une dentelle mouvante. Je sais que d’ici midi toute la cour en sera recouverte. Alors vite, vite, je fuis devant son avancée, je la précède, je la devance, c’est moi qui mène la danse et c’est ma course qu’elle poursuit.
Une douleur aigüe me traverse la poitrine et je me plie en deux. Au fond du parc, les deux silhouettes n’ont pas bougé, tournées vers l’ombre et leur tristesse plutôt que vers la lumière qui les éblouirait. Je me redresse. Le jour serait donc venu. Ce jour que j’attendais sans le désirer depuis ces derniers mois. Celui que j’avais compris ne plus devoir craindre, parce que quand le moment viendrait, c’est moi qui devrais lâcher prise et que rien ne servirait alors de le refuser.
Devant moi, ma balle rouge continue sa course. Bondissante et légère, elle file dans le vent. Je me lance à sa poursuite malgré la douleur et le feu qui envahit mon corps. Mes yeux s’arriment à sa couleur, tache de vie dans l’ombre qui envahit mon décor. Mes jambes déjà sont dans le froid, je ne distingue plus le bout de mes doigts. Ma balle roule et m’entraîne, et m’appelle à sa suite, je lui obéis, je n’ai pas peur, et j’entends le rire de papa ; puis mon ventre se contracte et je la vois, ma balle rouge, enfler, grandir, et s’alléger, soudain emplie de l’air qui me manque si fort, ma poitrine explose et voici que ma balle décolle et s’élève vers le ciel, alors je la rejoins et elle m’emporte, je ferme les yeux et quitte la terre, et je vois papa, qui me tend les bras, et me sourit.