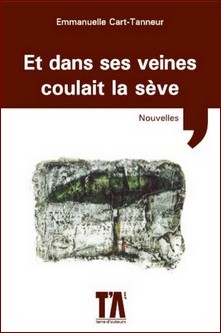– Amigo ! Amigo ! Faz favor, amigo !
L’enfant derrière nous poursuit sa litanie. Nous marchons, droit devant, feignant de l’ignorer, mais elle n’abandonne pas. Nos chemins ne se sépareront qu’à l’entrée de la résidence – à la frontière entre nos deux mondes.
Nous sommes arrivés il y a quelques heures, en milieu d’après-midi, en cette Roça restaurée pour l’accueil de touristes. Soudaine oasis civilisée surgissant, du beau milieu de nulle part, après trois heures de marche en pleine forêt équatoriale, une forêt que nous n’aurions jamais imaginée aussi luxuriante, dense et étouffante – bien davantage que ce que les guides nous annonçaient.
Nous passons brusquement de la touffeur de la forêt primaire aux allures préhistoriques, fougères arborescentes, ficus étrangleurs et magnolias géants, à l’apparente sérénité d’une propriété historique, vestiges d’une exploitation caféière du dix-neuvième siècle remis en état : maison coloniale repeinte couleur bois de rose, aux galeries de mahogany ombragées, aux jalousies rabattues laissant présager une bienfaisante fraîcheur intérieure, et au vaste jardin entretenu avec soin : herbe bien verte, coupée de frais, vasques de fleurs fraîches malgré le soleil de plomb, et salon de fer forgé – même si la table a perdu l’un de ses pieds, la perfection n’étant pas de ce monde
Comme partout à Sao Tome, point de luxe ni d’ostentation à Bombaïm : nous découvrons, à l’intérieur de la demeure, la simplicité des installations et la modestie des prestations : pas d’électricité ni d’eau chaude, décoration minimaliste voire inexistante, mais un mobilier colonial magnifique de sobriété (bois sombre, parquets cirés) et le soin apparemment apporté, bien qu’en toute simplicité, à sa mise en valeur. Tout cela nous convient parfaitement : nous ne sommes pas venus en colons ni en conquistadores – c’est tout juste si nous admettons notre statut de touristes. Et c’est avec bonheur que nous nous défaisons rapidement de nos équipements de marche pour aller faire un tour dans le parc de la propriété.
Appareil photo en main, nous nous éloignons de la maison principale pour partir à la découverte des autres bâtiments de l’exploitation, apparemment désaffectés et situés à une centaine de mètres, de l’autre côté du parc – l’un de nous, féru d’histoire coloniale, nous explique qu’ainsi le maître gardait un œil sur ses esclaves tout en se gardant du bruit et des odeurs qu’ils généraient.
Nous découvrons d’abord des ruines de bâtiments industriels, murs de pierres en lisière de forêt, que celle-ci envahit insidieusement année après année : les déceriseuses à café se recouvrent petit à petit de lianes et de feuilles géantes, les moulins disparaissent sous les racines des végétaux qui, lentement mais sûrement, reprennent leur place sur ces terres que l’Homme leur avait arrachées quelque siècles auparavant.
Un peu plus loin, voici la maison du géreur, nom que l’on donnait au contremaître : une habitation de bois blanc, à un étage auquel on accède par un escalier couvert, lui aussi, de végétation, aboutissant à une galerie ombragée – reproduction a minima de la maison du maître et petit symbole de l’autorité hiérarchique de son locataire vis-à-vis de ceux qui vivaient plus loin.
Nous marchons, dans ce parc, devant ces bâtiments, prenant quelques photographies, curieux de découvrir ces restes de vies de labeur, de mouvement, d’activité industrielle et ouvrière, qui semblent destinés à sombrer dans l’oubli de tous – le déclin même du tourisme, déjà difficile à faire survivre, sur l’île, l’annonce déjà ; et nous ressentons une certaine tristesse mêlée de respect pour ceux dont la vie entière s’est déroulée là, entre les champs de caféiers et les murs de l’usine, et dont il ne restera bientôt même plus un souvenir.
Dans ce décor oublié, nous sommes seuls, cinq personnes sur cet hectare de terre silencieux, calme, comme abandonné. Si nous n’avions pas vu l’homme qui nous a indiqué nos chambres, un peu plus tôt, dans la maison rose, nous pourrions nous sentir tels des Robinsons débarqués par hasard dans une ville fantôme.
Nous progressons, écoutant notre spécialiste nous apprendre quelques détails sur l’histoire industrielle et les conditions de vie qui furent celles des habitants de ce lieu, quand l’Histoire nous rattrape au coin d’un pan de mur : sur notre gauche, s’ouvre soudain une rue entière, un alignement de bâtisses au toit de tôle et aux murs de terre, sans portes ni fenêtres, aux ouvertures masquées de panneaux de carton récupéré ou de paille rassemblée à l’aide d’une liane. L’endroit a pris les couleurs de la rouille, du vert sauvage, de la terre environnante.
Et soudain, une foule surgit à nos yeux : nous, qui nous croyions seuls, faisons face à des dizaines d’hommes, de femmes et d’enfants, assis là, sur le bord de leurs maisons, dans la terre, la poussière ou les flaques de boue, vêtus de hardes improbables que l’on devine récupérées de quelque don occidental. Chiens et cochons circulent lentement entre les groupes, comme écrasés par la chaleur. Des femmes semblent s’occuper à la préparation de repas, pelant des racines de taro, quelques enfants courent de part et d’autre de la rue ; mais la majorité de ces gens que nous perturbons visiblement dans leur quotidien semble totalement apathique, hommes affalés au bord des maisons, bouteilles de rhum circulant entre leurs mains, adolescents assis, le regard éteint, jetant à peine un œil à notre arrivée incongrue et que nous ressentons intrusive dans leur monde.
Nous avons atteint, sans nous y attendre, le quartier autrefois réservé aux esclaves, la rue case-nègres, l’endroit où ont vécu et travaillé les pères de ceux que nous découvrons aujourd’hui. L’esclavage aboli, les colons portugais sont partis, abandonnant à leurs esclaves affranchis la totalité de leurs propriétés, caféières, maisons et terres. Les terres ont été réparties entre les nouveaux propriétaires, chacun récupérant un petit lopin planté, le plus souvent, de café. Propriétaires, certes, mais sans domicile autre que celui qui leur avait été imposé depuis le début de la colonisation : faute d’endroit où s’installer, chacun est resté là où il était né, où son père, son grand-père et toute sa famille avant lui avait travaillé pour un maître, et où lui-même désormais devrait se contenter de vivre et de faire survivre les siens.
Les explications de notre historien sont interrompues par l’arrivée soudaine vers notre petit groupe de deux, puis trois enfants, bientôt imités par une dizaine d’autres garçons et filles qui nous entourent, criant bruyamment en nous montrant leurs vêtements et en tendant vers nous leurs mains terreuses. Nous qui partions l’esprit ouvert, nous qui avons distribué avec bonheur des vêtements dans les villages précédemment traversés, et qui avons photographié tant d’enfants avec plaisir, devant leurs rires en découvrant leur image sur nos appareils numériques, nous sentons soudain, inexplicablement, agressés par leur misère. Il émane de cet endroit une impression de dégénérescence, de fin de civilisation, de perte de tout espoir. Le contraste est brutal entre la sérénité du lieu que nous étions en train de découvrir et la violence de l’afflux de ces enfants et de leurs demandes qui ressemblent davantage à des exigences, même si leurs mots sont pacifiques :
– Amigo ! Amigo ! Faz favor, amigo !
Dans d’autres villages, nous avons parfois noué des contacts, échangé sourires ou regards. Ici, cela nous semble impossible. Pourquoi ? Nous ne pourrions l’expliquer, et pourtant il nous paraît nécessaire, voire urgent, de rebrousser chemin, de fuir, de nous éloigner au plus vite de cet endroit empreint de misère et de malheur. Leur rencontre a entaché notre enthousiasme, a donné à notre découverte un côté sombre, négatif, pénible. Nous ne sommes pas fiers de ce que nous ressentons mais ne parvenons pas à ressentir l’envie de les connaître. Ils nous suivent, nous harcèlent, nous trébuchons dans les jambes des petits qui se faufilent entre nous, toujours la main tendue et à la bouche, la même litanie :
– Amigo ! Amigo ! Faz favor, amigo !
Que veulent-ils ? Des bonbons ? De l’argent ? J’ai quelques dobras sur moi et suis tentée de les leur donner mais l’ historien m’arrête :
– Laisse, tu les as vus ? Ils sont alcooliques et dégénérés, on ne peut rien pour eux … Ne donne rien ou on ne s’en sortira pas !
Les ignorer est difficile ; la culpabilité s’ajoute au malaise alors que nous nous éloignons rapidement de leur quartier, nous dirigeant, comme en quête d’un refuge, vers la maison rose.
Devant nos refus, les enfants se sont peu à peu détachés de nous, et sont repartis. Seule reste à nos trousses une enfant aux yeux sombres, qui s’entête :
– Amigo ! Amigo ! Faz favor, amigo !
Elle n’a pas plus de treize ou quatorze ans, elle est pieds nus, vêtue d’un tee-shirt déchiré et d’une jupe de cotonnade qu’elle a rabattue sous son ventre : elle est enceinte de plusieurs mois déjà, et nous désigne son état d’un geste répétitif, alternant avec celui de la main tendue. Qui est le père ? Le sait-elle seulement ? Elle n’est pas la seule jeune fille enceinte de Bombaïm, nous en avons rapidement vu d’autres tout à l’heure, dans la rue grise qui semble abriter une seule et même grande famille, une communauté consanguine, une tribu d’un vestige d’humanité unie dans la même misère et le même isolement.
Nous fuyons, honteusement. Tentons de ne pas l’entendre, de ne pas voir ce qu’elle nous montre comme une raison de plus de l’aider, sans doute, mais que nous prenons maintenant, malgré nous peut-être, comme un mauvaise raison de nous apitoyer davantage sur ces gens qui nous ont agressés dans la quiétude de nos vacances.
Elle nous suit, ses pas dans les nôtres. Elle ne sourit pas. S’obstine à nous appeler « Amigo » alors que nous ne méritons certainement pas ce mot. Nous avons cessé de lui dire « Non », nous contentant maintenant de cette reculade honteuse, de cette retraite précipitée, mutiques, fermés, définitivement d’un autre monde que le sien.
La femme-enfant n’abandonne que lorsque nous franchissons le seuil de la maison du maître. Réminiscence d’interdits subis par ses pères, ou résignation ultime devant notre refus de la voir, elle rebrousse chemin et s’en retourne vers les siens.
La soirée disperse quelque peu le malaise de cet épisode ; nous dînons, seuls dans le grand salon, servis par un garçon souriant et loquace, qui semble seul à prendre les commandes, cuisiner et servir.
Lorsqu’il se retire, nous évoquons entre nous, a posteriori, les conditions de vie de ces descendants d’esclaves dont la rencontre nous a tant marqués : nous nous sentons, alors même que nous habitons la maison du maître, tels les colons arrivant en pays conquis et se devant d’ignorer le peuple qui l’accueille. Comment vit-il, ce peuple ? De quoi vivent-ils ? Que savent-ils du monde alentour ?
Peut-être ignorent-ils jusqu’à l’idée de la mer, qui n’est pourtant qu’à quelques kilomètres de chez eux, au-delà de la barre rocheuse qui les en sépare … Et quand bien même ils la connaîtraient, traverseraient-ils la jungle, nu-pieds, pour partir vers l’inconnu ? Ils sont prisonniers de leur monde et de leur histoire, isolés géographiquement et culturellement. Et il nous semble que nous n’aurions pas pu, de toute façon, les aider de quelque façon que ce soit à échapper à leur condition – piètre auto-excuse pour notre conduite peu admirable de l’après-midi …
Bombaïm s’assombrit et chacun se retire dans sa chambre, à l’abri d’une moustiquaire et dans le bruissement de la jungle nocturne.
Une nuit passe à Sao Tome.
***
Au réveil, le lendemain matin, nous nous retrouvons accoudés au balcon de la galerie, patientant, brosse à dents à la main, à la porte de l’unique salle de bains.
Des bruits de voix attirent notre attention en contrebas.
Ils sont six ou sept, venus du fond du parc, de leur rue case-nègres, un homme et deux femmes, suivies de quelques enfants, qui se mettent au travail en discutant.
Et je la reconnais.
Parmi ces deux femmes, il y a cette gamine de la veille, cette petite fille enceinte, courbée jusqu’à terre, tenant son ventre d’une main dans un geste presque naturel, de l’autre une simple faucille avec laquelle elle coupe l’herbe que nous avons foulée la veille ; et qui progresse, pas après pas, suivie de ces enfants dont le plus jeune est déjà peut-être le sien, sur ce parc d’un hectare au moins, lentement mais sûrement, et avec une grâce bouleversante …
Cette pelouse parfaite que nous avons remarquée à notre arrivée, c’est elle, ce sont eux, qui l’ont coupée, qui l’entretiennent jour après jour. Ce sont eux aussi, sans doute, qui viendront remettre les chambres au propre après notre départ, préparer fruits et légumes pour ceux qui arriveront ensuite, et peut-être aussi réparer telle ou telle porte ou telle essente manquant à la toiture.
Lorsque nous quitterons Bombaïm, une demi-heure plus tard, passant devant eux, je tenterai de lui adresser un sourire, qu’elle ne verra pas.
Ils n’ont pas besoin de notre pitié, encore moins de notre condescendance.
Ils étaient là avant nous, et y seront toujours après ; leurs enfants leur y succèderont à leur tour, et nous ne pourrons nous empêcher de nous demander de quoi sera fait leur avenir, dans cette Roça, ou dans une autre, ou, s’ils partent un jour, bien loin, peut-être, de Sao Tome.