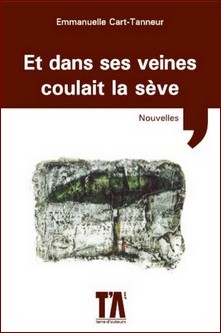J’ai dix ans, et je suis libre. Libre comme l’air, comme un nuage, comme la fourmi que j’évite, délicatement, en traversant la grande route. J’ai une très bonne vue et je remarque toujours les insectes qui traversent la rue. Personne ne fait attention à eux. Les voitures les écrasent, et moi je les entends crier. Je les vois souffrir, aplatis sur l’asphalte, et quand ils sont encore intacts je les ramasse doucement, et les enterre, dans de petits trous que je creuse dans le parc du foyer.
La grande route borde le foyer. Je crois qu’au bout, il y a la ville ; mais je n’en suis pas sûr, parce que je n’y vais pas souvent, voir un docteur ou quelque chose comme ça. A chaque fois il y a maman, avec moi, qui soupire. Et à la fin on lui dit que tout va bien. Tout va bien, elle répète ; et encore une fois, elle soupire.
On n’a pas le droit de sortir sur la route ; mais moi, je n’obéis pas. Parfois, je ne sais pas pourquoi, je me dis que je suis grand, que je suis moi, et que je suis libre. Je regarde le grillage qui entoure le parc, et je me dis qu’il ne me fait pas peur. D’ailleurs voilà : ce soir encore, je suis sorti. J’ai tordu le fil de fer dans un coin et ça s’est détricoté tout seul, comme le pull de Joce quand j’ai commencé à en tirer un fil et qu’elle s’est retrouvée toute nue. On m’a crié dessus ; n’empêche que c’était drôle. Même Joce a trouvé ça drôle ; elle me l’a dit après avec ses yeux et moi je l’ai bien compris. Un jour peut-être j’emmènerai Joce avec moi de l’autre côté de la route. Je lui dirai de ne pas faire de bruit, mais pour ça je n’ai pas peur, elle ne parle pas, jamais, alors ça devrait aller. Juste parfois elle pousse un grand cri, comme ça, pour rien, et ça surprend mais ça s’arrête aussitôt, alors si on y est habitué ça va. Moi depuis le temps que je suis ici j’y suis habitué. Alors ça va. Il n’y a pas de raison que ça arrive juste le jour où je l’emmènerai.
La première fois j’ai eu un peu peur. Et puis j’ai vu que dehors c’était pareil qu’au foyer ; la même herbe, le même soleil. Juste les voitures qui passent mais une fois la route traversée, il n’y a plus de danger. En face, il y a un grand champ, avec tout au milieu, un gros, gros arbre très vieux, avec de grosses branches toutes tordues qui me rappellent les gros doigts noueux de papa quand il est venu me voir pour la dernière fois. J’ai oublié son visage ; mais je me rappelle ses doigts. Et le bruit de sa canne quand il est parti. Je faisais au revoir avec la main mais il ne s’est pas retourné. Je ne sais pas pourquoi il ne vient plus. J’ai demandé une fois à l’éducateur qui m’a répondu » Il est là-haut, maintenant. ʺ Là-haut ? Où ça ? J’ai regardé le ciel, et je n’y ai vu que des nuages fins comme de la laine ; comment papa aurait-il pu s’y accrocher ? J’ai cru qu’on m’avait menti, mais la nuit suivante, j’ai compris : je m’étais sauvé par la fenêtre de ma chambre, pas loin, juste dans le parc, parce que la nuit était si belle et les étoiles si brillantes, et que j’avais envie de les compter. Et soudain c’est la lune qui m’a ébloui, elle brillait si fort, comme un soleil de nuit, et j’ai compris que c’était là-bas qu’il était, papa. Il doit y avoir retrouvé des tas d’amis et peut-être aussi des enfants ; l’année dernière Quentin a quitté le foyer et on nous a dit la même chose, qu’il était parti » là-haut ʺ : et enfin je comprenais ! Ils y étaient tous là-haut : la preuve que la lune est habitée, c’est qu’il y a de la lumière. Je me suis dit que chacun d’entre eux laissait une lumière allumée pour qu’en bas, ceux qu’il aimait sachent qu’il était là, qu’il pensait à eux, et qu’il les regardait continuer à vivre, en attendant de les retrouver. Je me suis allongé dans l’herbe ; elle était froide, mais douce. J’ai regardé le ciel un moment, puis j’ai fermé les yeux. Et je crois que j’ai rêvé. Il y avait maman, et quelqu’un comme papa, mais avec des cheveux, et un rire si chaud, et des bras si forts, qui me portait sur ses épaules, et puis qui me laissait glisser le long de son dos, et ensuite saisissait mes poignets, et se mettait à tourner, tourner sur lui-même en me faisant tourner, tourner autour de lui et peu à peu décoller, et je revoyais le monde absolument bouleversé qui ondoyait autour de nous deux, et le seul point fixe des yeux de papa qui riait et me regardait aussi, et ça allait vite, vite, de plus en plus vite, comme une toupie folle et je commençais à crier, peut-être à avoir un peu peur, mais papa riait si fort qu’il n’entendait pas mes cris, et moi j’entendais aussi ceux de maman qui criait Arrête ! mais lui continuait et je sentais mes mains glisser, et les siennes aussi et soudain, il m’a lâché, et je ne me rappelle que des cris, ceux de maman, de papa et de gens accourus autour, moi je ne voyais plus rien, ma tête allait exploser, ça tapait là-dedans comme avec un marteau, de plus en plus fort, et puis il y a eu un dernier éclair, éblouissant, et je me suis évanoui.
Le cauchemar m’a réveillé en sursaut. J’ai touché ma tête et j’ai été rassuré : je n’avais rien. J’avais rêvé. Même si cela ressemblait tellement à de la réalité. Je suis rentré sans faire de bruit, par ma fenêtre entrouverte, après avoir envoyé un baiser de la main, tout là-haut, à papa qui me regardait.
Cela va faire trente ans que j’ai dix ans ; c’est ce que l’éducateur a dit à maman hier. Je les ai entendus, mais ils ne m’ont pas vus. Je n’ai pas bien compris ; Maman soupirait, et l’éducateur a mis sa main sur son épaule.
Je n’aime pas que maman soit triste. Moi, j’aime avoir dix ans. Alors tant que ça durera, je serai heureux, et j’espère qu’elle pourra l’être aussi.