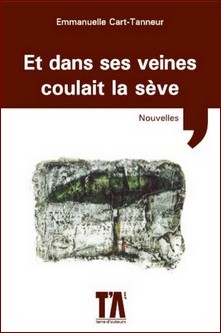Ils n’étaient pas spécialement beaux.
Pas vraiment jeunes, non plus.
Ils étaient juste là, dans les jardins du Palais-Royal, en cette fin d’après-midi venteuse d’octobre.
Moi, je ne faisais que passer. Comme tous les samedis, à la même heure, après mon atelier d’écriture.
La séance qui venait de se terminer avait été particulièrement difficile pour moi ; on avait dû imaginer, puis écrire, une scène d’amour. » Soyez libres, lâchez-vous, faites appel au vécu ! » avait lancé notre animateur, avec de larges mouvements de bras et toute la faconde qui le caractérisait – mais qui, à moi, déplaisait, sans que je ne puisse m’expliquer pourquoi.
L’amour, moi, je n’y croyais pas. Alors, faire appel au vécu, non, décidément, je ne préférais pas. – I would prefer not to, comme le répétait Bartleby, le héros de Melville … mais je n’étais pas une héroïne de roman, simplement une apprentie-auteure, et si je voulais progresser il me fallait bien obéir aux consignes.
J’avais donc soupiré et, après un moment passé à observer mes compagnons gratter du papier alors que j’étais proche de l’agraphie totale, j’avais inventé de toutes pièces une rocambolesque histoire que n’aurait pas reniée Feydeau – moi qui détestais a priori le théâtre de boulevard.
Grâce au Ciel – ou plutôt à la fuite naturelle du temps ! – j’avais été dispensée de la lecture à voix haute de mon œuvre, que je m’étais empressée de réduire en miettes.
Et j’avais fui, davantage que quitté, cet atelier dont je me demandais une fois de plus s’il était vraiment fait pour moi – ou si, moi, j’étais faite pour lui. Je n’étais pas écrivaine, et ne le deviendrais sans doute jamais. Le fantôme de Colette pouvait bien sourire de mes vaines ambitions depuis les fenêtres de son appartement, juste au-dessus de moi.
C’est dans cet état d’esprit pénible, mélange de découragement, de déception et d’une mélancolie qui semblait me coller à la peau, que j’étais entrée au Palais-Royal, par la rue de Beaujolais. Je ne prêtais qu’une attention distraite à ce qui m’entourait, n’ayant envie que de la solitude de mon appartement et pressant le pas afin de la retrouver au plus vite.
C’est en passant le Conseil d’État que je les aperçus : un couple, un homme et une femme, sans signe particulier, ni jeunes, ni vieux, du moins me sembla-t-il au premier regard. Ce qui m’avait attirée, alors que je marchais d’un pas rapide le long des allées, c’était leur immobilité apparente. Ils étaient tous deux appuyés au mur d’une colonne, de celles qui rythment les arcades illuminant stroboscopiquement les boutiques et les cafés qui s’y nichent.
L’homme y était adossé, et la femme était dans ses bras, tout entière emmitouflée par les longues manches de son compagnon dont le manteau les enveloppait tous les deux en un cocon protecteur.
Ils s’embrassaient. Leurs lèvres jointes étaient le trait d’union humide et chaud entre leurs deux corps dont on peinait à distinguer les limites propres. Tels une chimère surgie d’ailleurs, ils incarnaient l’unité sublime du couple en fusion dans l’état amoureux.
Je ne pus que m’arrêter pour les contempler. Moi qui me serais farouchement défendue d’être une voyeuse, je me surpris à rejoindre le tronc d’un marronnier derrière lequel je me rendis invisible, et m’abandonnai à leur contemplation.
À bien y regarder (ce que je pouvais désormais faire en toute indiscrétion), l’homme devait être plus vieux que sa compagne. Des cheveux gris striaient par endroits son abondante crinière, étonnante masse fuligineuse qui se confondait avec le col de son pardessus taupe. Ses mains étaient invisibles, apparemment enfouies dans l’épaisseur du vêtement qui les enveloppait tous deux ; on devinait cependant l’enlacement dans les légers mouvements qui animaient le manteau. Uni par les lèvres, le couple parachevait sa symbiose par les caresses, rendant sa communion mouvante et vivante comme le battement anarchique d’un cœur insoumis.
La femme, petite et mince, semblait menacer de disparaître dans l’étreinte. Couverte jusqu’aux pieds par le vêtement de son amant, et coiffée d’un large bonnet de laine, elle n’existait au regard que par son visage, dont la peau lactescente contrastait avec le tissu sombre. Ses yeux étaient clos, tout comme ceux de l’homme, et les bouches se rejoignaient aussi parfaitement qu’une image en miroir. Malgré la délicatesse de l’une et la force de l’autre, leur couple semblait matérialiser la communion parfaitement proportionnée entre deux êtres dont la survie isolée ne serait plus imaginable.
J’ignore combien de temps je restai derrière mon arbre à les observer. Le temps me sembla avoir été suspendu jusqu’à ce que je revienne à moi et réalise que la nuit était tombée.
L’homme et la femme s’embrassaient toujours.
C’est à regret que je repris mon chemin, abandonnant à regret la vision qui m’avait soustraite à des préoccupations qui me parurent alors totalement prosaïques et sans aucun intérêt.
Je ne m’attendais pas à les revoir et pourtant, je fus stupéfaite, le samedi suivant, par leur présence retrouvée, au même endroit, alors que je rentrais chez moi, à peu près à la même heure. Leur allure même n’avait pas changé : toujours ce manteau ample et sombre pour lui, ce bonnet informe pour elle, toujours cette étreinte, toujours cette communion fascinante ; et j’avoue que je cherchai à retrouver mon marronnier d’observation pour reprendre mon poste, duquel je contemplai, pétrifiée à nouveau, ce baiser sans fin.
Ils furent là, sur mon trajet vespéral, chaque samedi d’octobre. Puis novembre vint.
Les vacances de la Toussaint avaient suspendu les séances d’écriture, et je quittai Paris le temps d’une semaine de repos.
L’atelier reprit. Les vacances loin de la ville m’avaient fait beaucoup de bien. Je sentais, inexplicablement mais avec une chaleur au cœur et à l’esprit, que mon écriture se construisait, se développait, acquérait de la force et de la rigueur, en même temps que de l’autonomie et de la vitalité. Je prenais confiance en moi, et l’animateur de l’atelier m’avait fait part de sa satisfaction encourageante devant mes derniers écrits. J’allais mieux. Je pourrais peut-être envisager de trouver la vie intéressante, surtout si l’écrire pouvait effectivement m’y aider.
Je me sentais si bien que j’en avais totalement oublié mes visiteurs du soir. C’est en rentrant chez moi, ce premier samedi de reprise des cours, que je m’aperçus que je ne les avais pas vus ; ou plutôt, que je n’avais pas songé à les chercher. Peut-être n’étaient-ils simplement pas là. Mais je ressentis alors une vague tristesse, semblable à la nostalgie ressentie à la pensée d’un ami disparu. Et ce sentiment se fit de plus en plus pressant, au point que je cédai à l’impérieux bien qu’inexplicable besoin de ressortir, et de revenir sur mes pas, jusqu’aux jardins du Palais-Royal.
Poussant le portillon, je me fustigeai de mon émoi puéril et de mon impatience. Quelle chance avais-je de les revoir, et quand bien même ils seraient absents, quelle importance cela pouvait-il bien avoir ?
Je pressai néanmoins le pas. Les arcades défilaient à ma droite, tandis que le jet d’eau de la fontaine, à ma gauche, crachotait ses dernières gouttes : il faisait presque nuit.
Je souris largement en les apercevant, quelques dizaines de mètres devant moi, adossés à leur même colonne, et je réalisai que pas un instant auparavant je n’avais été surprise de les retrouver, semaine après semaine, au même endroit et dans la même posture, comme si leur présence était allée de soi, comme s’ils n’étaient pas soumis aux contraintes de la réalité et que je ne doive pas m’étonner de la constance de leur présence.
Le cœur battant et étrangement soulagée, je m’approchai. Les terrasses des cafés remballaient leurs dernières tables, les boutiques de souvenirs fermaient leurs portes. Les touristes désertaient peu à peu les lieux, les passants se raréfiaient, hormis ceux qui pressaient le pas en direction de la Comédie-Française.
Le couple semblait parfaitement étranger à ce qui l’entourait. Sombre et immobile, il aurait été difficile à repérer au milieu des ombres nocturnes, mais je connaissais son existence et me dirigeais vers lui avec assurance – mêlée de la prudence que j’avais toujours conservée dans cet affût clandestin.
Je repérai vite ma cachette habituelle, mais la nuit était si noire que je pensai ne pas avoir besoin de me cacher pour les voir suffisamment. Je m’approchai.
Peu à peu, je fus intriguée par leur immobilité. Les amples mouvements des caresses sous le tissu ne m’apparaissaient plus. Était-ce l’obscurité ? Je me rendis compte que je discernais mal leurs visages. Celui de la femme était pourtant, dans mon souvenir, si pâle ! Était-il possible que l’on ne distingue plus aucun de leurs traits ? Et pourquoi cette raideur, cette fixité? J’outrepassai toute prudence en me rapprochant encore mais je devais comprendre : je constatai alors que leurs visages, leurs lèvres même, avaient perdu toute vie !
En proie à la panique, je tentai de rassembler mes esprits. J’étais à deux mètres d’eux et je pris ma tête dans mes mains pour essayer de me calmer. Puis, relevant les yeux, j’avançai dans leur direction: ils ne bougeaient toujours pas. Je remarquai que le visage de la femme avait noirci ; pris la couleur du manteau et de la chevelure de l’homme. Leur baiser n’avait pas cessé. Mais leurs lèvres semblaient soudées d’une façon irréversible.
J’étais à un mètre. Ils ne me voyaient pas. Plus près, encore. Je n’existais pas pour eux.
Je tendis la main.
Un contact froid me fit reculer d’un bond. Le toucher de la pierre. La froideur du marbre.
J’étais devant une statue, représentant un couple qui s’embrassait.
Les jours suivants, fut annoncée dans la presse culturelle l’inauguration d’une exposition de sculptures dans les jardins du Palais-Royal.
On recommandait tout particulièrement » Le Baiser « , d’inspiration très rodinienne et dont l’originalité tenait à l’intégration admirable des personnages à leur support, une colonne de la galerie Ouest.
J’ai écrit mon premier roman le printemps qui a suivi.
Il commençait par la longue description d’un baiser.
Texte paru dans Les Histoires de la Lampe de Chevet, tome 5 (2010)