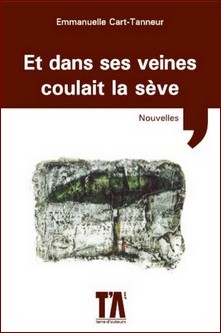Un jour,
un jour, peut-être bientôt,
un jour j’arracherai l’ancre qui tient mon navire loin des mers.
Je suis le gondolier de Vincennes. Chaque jour, du matin à la tombée de la nuit, vous êtes des centaines à vous approcher de ma bicoque au bord du lac : Location de barques, 11 euros l’heure, caution 10 euros – Passage vers l’île de Reuilly, 3 euros – de mars à novembre, tels sont les mots qui vous attirent et vous pressent autour de moi.
De mars à novembre, j’enregistre, j’encaisse, je distribue les papillons verts et bleus qui certifient votre achat, votre billet d’entrée dans mon monde, celui du canotage étroit, ou de la traversée dérisoire. Car si certains d’entre vous sont prêts à ramer, dans un sens puis dans l’autre et le temps d’une heure, le long des berges entre le bord et l’île, nombreux sont ceux qui n’ont besoin que de passer en face pour aller marcher un peu ou s’y étendre sous les saules – la passerelle qui le permet aussi est trop loin, cinq cent mètres que vos jambes de promeneurs du dimanche rechignent souvent à parcourir.
Je vous embarque alors, laissant le guichet à mon collègue le temps d’aller puis revenir, pour un passage de cinq minutes à bord de cette barque à fond plat dans lequel je vous entasse à six ou huit. Moi, je reste debout sur la plate-forme arrière et j’empoigne la longue perche qui propulsera notre embarcation en direction de l’autre rive. Les dames en crinoline et les bourgeois en frac ont disparu, mais je me plais à les imaginer enjamber le petit ponton ; aujourd’hui presque tous mes passagers sont étrangers – Américains, Chinois et même Russes m’offrent leur confiance pour ce qui leur restera comme un souvenir follement romantique de Paris. Peuples du monde que je côtoie au quotidien quand je n’ai jamais quitté la France, combien j’aimerais vous questionner si nous pouvions seulement converser ! Comment est-ce, là-bas ? Comment est-ce, chez vous ? Et l’océan, dites-moi, l’océan ?… Mais vous ne l’avez peut-être même pas regardé quand vous l’avez survolé.
Voilà longtemps, si longtemps – trop longtemps déjà ! que je navigue sur ces eaux trop grises et trop plates, moi qui depuis toujours ne rêve que de mers mouvantes et de vivifiantes tempêtes.
De la fenêtre de mon appartement, à Charenton, les seules eaux que j’aperçoive sont celles de la Seine au courant monotone et glauque – éternelle et inexorable platitude, triste reflet de ma vie.
Cela va faire quarante ans que je rame sur le lac du Bois de Vincennes. De mars à novembre, je navigue chichement, je traverse pauvrement, dix minutes sur l’eau pour vingt à terre, le tiers de mon temps les mains poussant sur ma perche et le restant recomptant la monnaie, découpant selon les pointillés et vous souriant internationalement, sans cesser de rêver. Mon rêve, vous ne le verrez pas : il est punaisé au dos de la porte, depuis si longtemps que je l’y ai toujours vu. La transat en solitaire, ses bateaux et ses marins, ses moyennes et ses records, j’en sais tout depuis sa première en 1960. Quarante jours pour Chichester, seulement huit pour Desjoyeaux. Mais qu’importe la performance ; ce qui me plaît, m’attire, me passionne, c’est la liberté que je lis dans leurs yeux, la force du vent qui les soumet sans les vaincre, la sauvagerie des vagues et des courants qu’ils dompteront tous au final. Quels hommes ! Quels destins ! Quelle vie !
Ma vie à moi est minimale. Solitaire, je le suis, bien qu’ entouré du monde. Solitaire, je le resterai, mais ailleurs.
Ailleurs !
Alors, je m’entraîne.
Chaque soir, quand je ferme le portillon d’accès aux berges, je m’enferme dans ma baraque et me plonge dans des récits de marins et des mémoires d’aventuriers. Christophe Colomb me confie la barre, Marco Polo m’entraîne à sa suite, Tabarly m’accueille à son bord, et vogue le navire ! Quand la nuit tombe et que le Bois se fait désert, je sors et, sous la lune, je détache une barque, et je m’évade… L’univers s’élargit et l’île s’éloigne – bientôt je n’aperçois plus les saules. Les eaux plates s’animent sous les poussées de ma perche qui se mue en une rame solide et me propulse au large. Je dépasse le temple oriental, saluant au passage les bonzes qui m’encouragent, et je m’élance, je file, je trace, vers l’horizon et les espaces infinis de mes rêves.
Depuis quelques jours, depuis quelques nuits, je ne rentre plus à Charenton. Le petit matin me retrouve endormi à bord d’une barque dérivant quelque part sur le lac. Le gardien me réveille en me hélant ; sans doute croit-il que j’effectue quelque traversée de maintenance du matériel. Il me dit rêveur. Il n’a pas tort. Je rêve, mais je sais que j’ai raison.
Je serai bientôt prêt.
Un jour,
un jour, peut-être bientôt,
un jour j’arracherai l’ancre qui tient mon navire loin des mers.
Alors,
alors ce jour béni
sera celui de ma renaissance
à la mer
à ce monde
et à la vie.