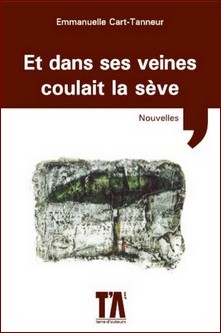Papa le disait sans arrêt : il fallait qu’on sorte du bois. Pas d’avenir pour nous ici, tu vois bien, répétait-il à ma mère de plus en plus souvent. Pauvre Maman qui faisait son possible pour faire comme si de rien n’était, alors que nous voyions bien, mes frères et moi, que Papa avait raison, qu’il allait bien falloir qu’on se fasse à cette idée, et que les efforts de Maman pour nous le cacher resteraient dérisoires.
Nous avions pourtant été si heureux dans cette maison ! J’y étais né, ainsi que tous mes frères et tant de générations avant nous, et jamais je n’aurais songé qu’un jour on voudrait nous en chasser. Que j’aimais les vieilles poutres, les huisseries anciennes et les portes vétustes de cette demeure séculaire qui avait vu passer et avait abrité tant des nôtres au fil du temps ! Leur souvenir aurait aisément pu me laisser un goût amer, celui du temps passé et des choses révolues…
Chaque matin, au réveil, je rejoignais la foule laborieuse, attelée au devoir bien avant moi ; notre organisation voulait que le travail ne cesse jamais, afin que la productivité soit maximale. A peine une tâche était-elle achevée qu’on nous en désignait une autre, et il n’était pas question de repos, encore moins de vacances : nous enchaînions les missions, muets et obéissants. Il n’était pas question, quoiqu’il en soit, de nous rebeller, car tel était simplement notre destin.
Bien sûr, nous étions fils du Roi, mais cela ne nous ouvrait aucun passe-droit : fils du Roi, nous l’étions tous – j’avais fini par le comprendre, trop tard, hélas – ma cécité m’en avait sans doute empêché, ou protégé ; car quelle désillusion de se découvrir un parmi tant d’autres, insignifiant, simple partie infime d’un tout si important, grain de sable dans l’univers de notre famille !
Fils du Roi, nous étions également ceux de la Reine : si Papa jouait son rôle avec zèle, ne quittant jamais les appartements royaux pour rester à ses côtés, notre génitrice bénéficiait, quant à elle, d’un respect sans égal. C’est une foule grouillante qui se pressait chaque jour auprès d’elle, serviteurs soumis et prêts à tout pour que Sa Majesté les remarque et les honore de sa reconnaissance. Bien que déjà incapable de se mouvoir, handicapée par son embonpoint, ma mère était nourrie en permanence, et en continu, par des ouvriers serviles et empressés et il m’a fallu du temps pour admettre que ceux-là même que je méprisais pour leur abnégation soumise n’étaient autres que des membres de ma famille, pire : d’autres enfants du couple royal de mes parents. Je me suis juré de ne jamais accepter ma condition d’anonyme progéniture et de tenter, à tout prix, de m’extraire un jour de ma caste.
Un matin que je vaquais à mes occupations, j’entendis la rumeur se préciser : la sortie du bois était imminente. Nous étions menacés, et Papa avait entrepris des démarches pour tenter de nous trouver un autre chez-nous. Il avait, pour cela, dépêché quelques représentants ailés chargés d’aller explorer les alentours, et leur rapport avait été alarmant : aucune maison ne nous serait bientôt plus accessible. La région, historiquement couverte de demeures aux charpentes en bois, connaissait depuis quelques années des ravages importants qui nous étaient imputés : les poutres s’effritaient, les toits s’effondraient, et les pouvoirs publics avaient décidé une action de grande envergure, qui n’était autre que… notre éradication totale ! Je fus pris de violents tremblements quand on me confirma cette nouvelle. Quoi ! Nous, inoffensifs termites, allions être exterminés ? De quel droit avait-on programmé notre génocide ? N’y avait-il point de place pour chaque créature divine dans ce monde ? On allait nous enfumer, nous gazer, nous réduire à néant, nous annihiler ! Je restai abattu un long moment avant de me remettre à la tâche, car j’avais une galerie à achever et il n’était pas question que j’abandonne le terrain avant l’accomplissement de mon travail . Je décidai de m’en remettre à sa sagesse paternelle ; après tout, nos parents nous avaient toujours garanti le gîte et le couvert, et je ne doutais pas qu’ils assumeraient leurs responsabilités jusqu’en ces circonstances dramatiques.
C’est à cette époque que je me liai d’amitié avec un termite bien né, que l’appartenance à une caste supérieure autorisait à assister aux Revues de Direction tenues par mes parents et quelques membres du Conseil Colonial. C’est ainsi que j’appris qu’il avait été envisagé, dans un premier temps, une reconversion totale de notre mode de vie. On nous chassait du bois, soit : nous nous adapterions ailleurs. Le projet de déménagement vers l’immeuble voisin tomba cependant vite à l’eau quand il fut rapporté que ses charpentes, récentes, étaient faites d’acier : jamais nos mâchoires ne sauraient s’adapter à un matériau aussi résistant et par ailleurs, a priori assez peu nourrissant. C’est que Maman avait de gros besoins et qu’il fallait assurer son ravitaillement ! Bientôt, toute la colonie fut mise à contribution et une boîte à idées fut placée à l’entrée des appartements royaux. Je n’ose imaginer ce qui y fut déposé, mais toujours est-il qu’aucune solution n’était encore envisagée le jour où les premières fumées apparurent, du fond de la Galerie Nord. Ce n’était au début qu’une brume légèrement opaque, mais très vite, les ouvriers situés près de la sortie furent incommodés et accoururent vers nous qui travaillions un peu plus loin, sonnant la retraite générale. Je n’oublierai jamais ce moment de panique totale, ces cris muets et cette débâcle inimaginable comparée à la discipline et à l’ordre qui régnaient encore au même endroit quelques heures auparavant. En une matinée, l’ensemble de nos galeries fut rendu inhabitable, et nous nous retrouvâmes quelques centaines de milliers d’individus sur le trottoir, apeurés, aveuglés par la lumière du jour et désespérés par le sort qui nous avait jetés dehors. Papa était introuvable – certains insinuèrent qu’il en avait profité pour s’éclipser et se soustraire à l’autorité de Maman qui venait juste d’être évacuée par une centaine d’ouvriers à l’aide d’un brancard de fortune, déposé à terre sans ménagement. La panique était totale et l’anarchie, à son comble.
– On fait quoi, maintenant ? s’interrogeait-on partout autour de moi.
Je sus que mon heure était peut-être arrivée et que, pour peu que je m’en montre digne, un grand destin m’attendait peut-être à l’issue de ce violent maelström.
– Suivez-moi ! lançai-je à l’assemblée qui, aussitôt, se tourna dans ma direction, puis vers Maman, quêtant en vain un accord de sa part, la Reine-Mère étant encore en train de reprendre son souffle après son épopée, et à nouveau enfin vers moi dans un élan de ferveur qui me remplit d’une confiance inattendue. Allons-y ! ajoutai-je dans un geste de la patte censé appeler à me suivre – je n’avais jamais fait cela de ma vie et fus rassuré de constater que j’étais compris : la colonie s’ébranla et se mit en route sur mes talons.
Je ne sais quel Dieu des insectes, ni quel hasard du Destin, m’apporta la solution que je n’avais pas osé imaginer : nous nous étions, sans le savoir, dirigés vers la Bibliothèque Municipale qui organisait, précisément ce jour-là, une journée Portes Ouvertes : il nous fut facile de pénétrer dans le bâtiment à la faveur du discours d’ouverture du Maire qui invita tout le monde à lui faire face et, par conséquent, à nous tourner le dos. En quelques minutes, nous étions dans la place.
– Y’a rien à becqueter ici ! entendis-je derrière moi. Je me retournai et appelai le mécontent à se taire et à me faire confiance : certes, l’armature des locaux, récemment construits, était métallique. Mais nous étions dans une bibliothèque ! Et que trouve-ton, dans une bibliothèque ? Des livres ! Et en quoi sont faits les livres ? De papier ! Oui, de papier, de goûteuse et délicieuse cellulose, dont les arômes parvenaient déjà à nos mandibules asséchées… C’est à grand-peine que je parvins à contenir la charge furieuse de mes congénères quand ils montèrent à l’assaut des collections et il me fallut toute la persuasion dont je me découvris capable pour les engager à me suivre un peu plus loin : là, on ne nous découvrirait jamais, et on ne nous chasserait pas. Je venais de découvrir, guidé par un instinct providentiel, la caverne d’Ali-Baba, la corne d’abondance, le Graal absolu : la réserve ! Antichambre de la déchetterie, il y croupissait plusieurs milliers d’ouvrages et de journaux rendus illisibles par l’humidité et la poussière, qui ne seraient manifestement jamais rendus au public et qui allaient pouvoir nous régaler des années durant, pour peu que l’endroit soit alimenté régulièrement… Mes compagnons se jetèrent sur les ouvrages comme s’ils n’avaient pas mangé depuis des mois, et l’endroit crépita bientôt de joyeux claquements de mâchoires accompagné de crissements de plaisir des antennes. De temps à autre, l’un ou l’autre de mes congénères levait la tête et me lançait un regard reconnaissant. Je me sentis gonflé de fierté et, en apercevant, tout au bout de la pièce, ma mère, exsangue et à bout de souffle, demander qu’on la dépose là et qu’on la laisse seule, je compris que j’étais désormais celui sur lequel chacun allait compter. J’en acceptai la charge et m’autorisai, enfin, maintenant que j’avais sauvé mon peuple, à me rassasier moi aussi de quelques bonnes pages.
***
Nous sommes aujourd’hui installés depuis six mois dans la réserve de la Bibliothèque, et je crois pouvoir dire que nous y coulons des jours heureux. Chacun y a pris ses quartiers et l’harmonie règne, à l’abri de toute menace – personne ne vient jamais là si ce n’est pour y déposer quelques livres abîmés, pour nous cerises sur le gâteau de notre menu quotidien – et dans la fierté du rôle que nous avons acquis dans la grande chaine du recyclage. J’ai été désigné Roi par défaut, Papa étant resté introuvable (je le soupçonne de s’être fondu dans un anonymat dont il avait, au fond, toujours rêvé) et je veille à la sérénité de la colonie.
Pour ma part, en tant que Roi, je me suis réservé les meilleurs morceaux : j’ai déniché l’intégrale de la Comédie Humaine, édition 1934, et j’attaque les Scènes de la vie de campagne. Quelle saveur incomparable !
… Comment je connais le titre de cet ouvrage délicieux ? A force de vivre parmi les mots, j’ai appris à lire, seul et en cachette. Nul n’est au courant, mais je m’octroie le double plaisir de décrypter les écrits que je dévore ensuite. La vie est belle au pays des livres, et jamais je ne regretterai d’être sorti du bois pour entrer en littérature !
(6ème prix au concours Calipso, Le Fontanil, 2012)