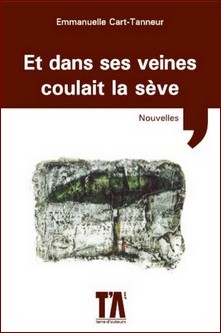Quelques marguerites, deux ou trois coquelicots, des fleurs de pissenlit, une branche d’églantier…
Encore quelques voyages et j’aurai terminé. Tant mieux : la nuit tombe, et je n’aime pas rentrer tard, même si ce soir, cela n’a plus guère d’importance.
Mais je dois retourner auprès de lui. C’est là qu’est ma place.
Je suis né dans une famille de spécialistes. Des professionnels dans leur branche, tous issus de la même origine, renommés de père en fils et destinés au même avenir.
J’ai ainsi, dès mon plus jeune âge, été séparé de ma famille et placé dans un centre d’apprentissage spécialisé. J’étais seul, loin des miens, mais telle était ma destinée ; je n’ai jamais pensé à me rebeller, et nul n’imaginait que je pourrais un jour faillir à ma mission.
Je me suis donné de tout mon cœur dans cette formation d’experts. J’avais soif d’apprendre, envie de mériter la reconnaissance de ma famille et de mes maîtres, et je savais la valeur de ma naissance et l’importance que tous y attachaient en espérant de moi les meilleures performances.
J’ai fait de mon mieux les premiers mois. J’étais parmi les plus zélés, les plus acharnés au travail, en rien avare de mes efforts pour me montrer digne des miens. Jour après jour, j’apprenais, je m’entraînais, à l’écoute du moindre signe de mes maîtres pour faire preuve de ma bonne volonté.
Ceux-ci ne semblaient pourtant pas réaliser à quel point je m’investissais dans cette mission, ni combien il était important pour moi, non seulement de réussir, mais surtout d’arriver dans les premiers au classement final.
De fait, il n’en a pas été ainsi. J’ai terminé ma formation sans que quiconque ne m’ait particulièrement remarqué, et c’est avec philosophie que je me suis résigné à ne pas être un champion – je me contenterais de faire mon métier et, par respect pour mes pairs et pour ceux qui me l’avaient enseigné, je le ferais de mon mieux.
J’ai rejoint la Brigade canine du Val-de-Marne, moins prestigieuse certes que celle des Sapeurs-Pompiers de Paris, mais dans laquelle j’ai très vite trouvé mes marques, et de bons amis de toutes races, labradors, Terre-Neuve et malinois, dont certains étaient là depuis plusieurs années et m’ont vite informé sur la nature des différentes missions que nous pourrions avoir à effectuer ensemble.
Il me tardait de partir sur le terrain, mais en attendant, nous passions le plus clair de notre temps à nous entraîner, guidés par nos maîtres-chiens, sur des circuits improvisés en extérieur ou dans les locaux de la gendarmerie. Là, on nous soumettait à l’épreuve olfactive. De petites quantités de poudres variées étaient dissimulées derrière des cartons, déposés dans les fissures des murs ou encore insérés entre deux lattes de parquet, et c’était à qui serait le plus rapide à les débusquer. Je voyais mal l’intérêt de ce jeu auquel je me pliais pourtant de bonne grâce, conscient qu’il s’agissait d’un exercice imposé et sans doute utile pour les missions à venir. Je me suis, de fait, montré assez peu performant en la matière, malgré tous mes efforts et mon envie de satisfaire mes supérieurs. Je devais admettre que je ne flairais pas grand-chose, et mes résultats s’avéraient parfois peu différents de ceux que j’aurais pu obtenir en fouillant au hasard. Je faisais de mon mieux, toutefois, et tentais de passer, avant tout, inaperçu dans mon inaptitude manifeste.
Je préférais, de très loin, les sorties nature : une fois par semaine, on nous menait en forêt, ou dans la campagne environnante, afin d’assurer notre quota d’exercice physique et nous permettre de nous reposer les naseaux. J’ai été surpris, les premières fois, de constater que les miens, au contraire, frétillaient d’une joyeuse impatience devant les senteurs multiples qui s’offraient à nous ! Alors que mes compagnons s’égaillaient en tous sens, je filais, à peine sauté du fourgon, entraîné par la première odeur que j’avais perçue, droit vers elle, et n’arrêtais ma course qu’une fois l’émetteur de l’envoûtant parfum identifié. J’ai très vite réalisé que ce qui chatouillait mes narines, ce qui faisait vibrer mes cellules olfactives et frémir mes neurones sensitifs, c’étaient les odeurs des fleurs… Combien de marguerites, de coucous, de violettes, de renoncules, combien de boutons-d’or, de coquelicots et de bleuets n’ai-je pas flairé jusqu’à la lie, avec l’impression de les dépouiller de toute leur senteur pour m’en imprégner moi-même telle une bienheureuse éponge ? Je reniflais, yeux fermés, tout à l’abandon de ces délicieuses sensations, pendant que les autres jouaient à chat ou à l’explorateur… Ils semblaient ignorer ce plaisir qui m’était offert et je les plaignais, en mon for intérieur, pour cette anesthésie sélective dont ils subiraient à vie la tristesse – car n’est-ce pas pure tristesse de de ne savoir reconnaître le parfum que d’un sachet de poudre ?
Deux mois après mon intégration au sein de la Brigade, nous avons eu la tristesse de perdre Brutus, l’aîné d’entre nous, victime d’un accident du travail : il venait de déloger vingt grammes de cocaïne dissimulés sous une plaque minéralogique, quand le sachet s’était rompu sous ses crocs trop zélés. Dans un réflexe malheureux, Brutus avait inhalé accidentellement une grande quantité de poudre. Il avait été retrouvé deux heures plus tard et cent cinquante kilomètres plus loin, courant toujours sur l’autoroute, mais à contresens, ce qui avait provoqué sa mort après une collision avec un poids-lourd qui n’avait pu l’éviter.
Une place se trouvait donc vacante dans le service de sécurité de proximité de l’aéroport d’Orly et c’est un peu au pied levé que j’y ai été affecté. Je ressentais autant d’excitation que d’appréhension mais j’étais, comme toujours, décidé à me montrer le plus efficace possible dans ce nouveau rôle que l’on voulait bien me confier.
A mon grand désespoir, cette mission a été pour moi un fiasco total.
J’avais pourtant révisé mentalement les planques possibles, essayé de me remémorer les odeurs si particulières – et pour moi si insignifiantes – de ce que j’étais censé dénicher, et tenté de compenser mes lacunes par une obéissance à toute épreuve qui, pensais-je, m’assurerait au moins une immunité discrète en cas de lucidité soudaine de mes maîtres face à mon incompétence.
La première valise que j’ai fait ouvrir, à la douane, m’avait pourtant valu de chaleureuses félicitations, ainsi qu’un délicieux morceau de sucre : nous avions arrêté, à l’arrivée d’un vol en provenance d’Amsterdam, un consommateur de marijuana qui pensait peut-être naïvement que l’import de plants de cannabis en feuilles était moins répressible que celui de drogue prête à l’emploi. Moi, j’avais flairé ses feuilles, malgré l’emballage qu’il avait réalisé autour, à base de papiers kraft et aluminium, à cent mètres au moins. Je trépignais d’impatience de pouvoir identifier cette merveilleuse et suave odeur jusque là inconnue de moi et j’ai été récompensé au centuple lorsque la sangle du bagage céda, livrant au regard triomphant des policiers, contrit du junkie et ébloui de moi-même la luxuriance de ce bouquet sauvage.
Encouragé et ayant retrouvé quelque confiance en moi-même après cette minute de gloire, je me suis pris à rêver que j’avais enfin trouvé ma place et obtenu la reconnaissance de mes pairs, et que je n’aurais plus à me faire de souci quant à mon avenir professionnel.
Las ! La suite m’a prouvé que non…
J’ai vite appris que, les soutes des avions étant soumises à de très basses températures, la plupart des passagers n’y déposent jamais de plantes fraîches. Mis à part notre amateur de hasch, qui l’ignorait apparemment, je n’ai jamais réussi, par la suite, à faire découvrir la moindre quantité de drogue dans les bagages qui passaient un à un sous mon nez ; j’étais d’autant plus mortifié quand un collègue se mettait à aboyer juste après moi et que l’on sortait du sac de voyage l’objet d’un délit qui m’avait totalement échappé. J’ai fini par friser le ridicule en me jetant, dans un accès de zèle incontrôlé, sur un voyageur qui rentrait de Madère, le sac à dos garni d’innocentes plantes grasses … Plainte fut déposée auprès de l’aéroport, transmise à la Brigade, et l’on me retira ma mission.
Ma formation m’offrait un autre débouché : j’ai intégré une unité de chiens de catastrophes, aux activités très ponctuelles mais aux responsabilités immenses – j’en étais très fier, et espérais, en faisant mes preuves ici, faire oublier mes échecs professionnels précédents.
J’ai pourtant nourri quelque inquiétude dès les premiers entraînements : l’odeur de l’humain est certes plus facilement identifiable que celle d’une poudre minérale, mais j’avais encore bien du mal à la détecter de prime abord, à plus forte raison quand elle se trouvait mêlée à d’autres effluves – en particulier d’origine végétale, qui dominaient toutes les autres pour moi. J’ai tu ce souci à mes collègues et n’ai eu, quoiqu’il en soit, que très peu le temps de me demander si j’étais fait pour ce métier puisqu’un tremblement de terre secoua l’Italie trois semaines après ma mutation. Je partis avec les autres, narines affûtées au mieux, mais surtout, angoisse au ventre.
Mes appréhensions se sont avérées justifiées : j’ai été lamentablement inefficace. Je n’ai réussi à sauver que trois villageois : un horticulteur, un fleuriste et une passionnée d’ikebana en pleine composition, au moment du séisme, d’un bouquet de lys et d’orchidées… et dramatiquement ignoré l’existence d’une dizaine d’autres personnes qui furent heureusement tirées d’affaire par mes collègues.
Comment vous décrire ce que j’ai ressenti à ce moment de ma vie ? De la honte, un sentiment d’inutilité, et surtout une profonde mésestime de moi-même. J’avais échoué. Je n’étais plus bon à rien. J’avais déshonoré ma famille, et toute ma race.
Je n’ai donc pas tenté de m’esquiver devant le sort qui m’a été réservé et que j’attendais avec résignation, telle une punition méritée : j’ai été abandonné. Laissé pour compte dans un foyer SPA de banlieue, un matin d’hiver, sans arme ni bagage.
Deux mois se sont écoulés. Deux mois durant lesquels je n’ai rien fait d’autre que ressasser mes échecs et tenter de trouver un sens à cette existence qui ne semblait plus m’en offrir aucun. J’étais soulagé, dans mon malheur, d’avoir coupé tout contact avec ma famille, car je serais mort de honte à l’idée de devoir me présenter à nouveau devant elle.
Mais qu’allais-je donc faire de ma vie ?
La réponse est arrivée un matin, telle un miracle auquel je ne croyais plus. J’étais si dégoûté de moi-même que je n’ai pas compris, de prime abord, que c’est de moi qu’il s’agissait lorsqu’un employé s’est dirigé vers mon enclos pour le décadenasser. De fait, ma voisine, une griffonne au demeurant fort sympathique mais quelque peu fatigante à cause de ses bavardages incessants, a tenté de bondir au-dehors, mis l’homme l’a repoussée à l’intérieur et m’a saisi par le collier, m’attirant hors de la cage. Je me suis retrouvé à terre, sur le sol poussiéreux du refuge, la truffe basse, redoutant quelque châtiment que je n’aurais même pas eu la volonté de fuir.
Mais j’ai vu se pencher vers moi, de toute sa hauteur, une silhouette sombre, senti une main se poser sur ma tête et vu deux yeux clairs qui m’observaient :
Veux-tu venir avec moi, mon beau ? m’a demandé l’homme en souriant.
Je ne saurais décrire l’émotion qui m’a saisi et l’euphorie avec laquelle j’ai accepté de suivre cet inconnu qui m’acceptait pour ce que j’étais, et c’est la truffe humide de joie que j’ai quitté le refuge pour grimper dans sa 4L blanche.
Cet homme, c’était le Père Fleury. Prêtre depuis près de cinquante ans, il n’avait jamais quitté, depuis, son petit village de la Beauce, assistant à son dépeuplement, aux ravages de l’exode rural et à la désertion progressive des églises des environs dans lesquelles il officiait depuis toujours. Sa vie quotidienne était facilitée par la présence d’une personne bonne et serviable, qui venait malheureusement de le quitter pour aller couler une retraite heureuse auprès de ses enfants, et il se retrouvait seul. Et s’il savait fort bien se débrouiller pour ce qui concernait le quotidien, il avait beaucoup de mal à ne plus avoir personne à qui parler …
Voilà tout ce qu’il m’a raconté, d’une voix douce et chaleureuse, sur notre trajet de retour. Du moins, c’est ce que j’ai compris en arrivant au presbytère, une maisonnette vieillotte mais confortable ; en entrant dans la cuisine, j’ai trouvé, avec un bonheur sans nom, un panier garni d’un mol édredon dans lequel je me suis lové en le regardant avec reconnaissance, avant de m’y endormir aussitôt.
Dès le lendemain, j’ai eu l’impression que j’avais toujours vécu ici. Je me sentais chez moi. Mon refuge, c’était cette maison, et l’amitié de ce saint homme.
Le Père Fleury était un homme simple, mais passionné, et l’une de ses passions était la botanique ! Passion dans laquelle il m’a entraîné, sans que cela, évidemment, ne me coûte le moins du monde – bien au contraire ! Je bénissais chaque jour le Ciel de m’avoir fait croiser sa route.
Plusieurs fois par semaine, nous partions herboriser le long des routes et des chemins, ou dans les bois qui entouraient le village. J’ai reconnu avec bonheur tant d’odeurs que je croyais avoir oubliées, et qui n’étaient qu’en sommeil quelque part dans mes souvenirs. Tel un jeune chien fou, je sautais de buisson en talus, composant des bouquets olfactifs sans cesse renouvelés, complétant ma parfumothèque personnelle, que j’enrichissais des connaissances scientifiques que m’apportait le Père Fleury. Grâce à lui, je suis devenu en quelques mois expert en pharmacognosie et en botanique. Moi, le bon à rien, j’étais très fier de me savoir détenteur de tout ce savoir, dont aucun chien de catastrophe ni d’aéroport n’aurait pu se targuer, j’en étais certain. Et quel plaisir sans fin que ces balades matinales avec mon maître, desquelles nous rapportions plants et racines, pétales ou rameaux, qui nous serviraient plus tard pour la cuisine, la confection de tisanes ou simplement pour agrémenter la maison, et dont les effluves parfumeraient des heures durant l’air que nous respirions !
Le Père Fleury continuait d’exercer sa mission, à l’église du village ou au sein d’autres paroisses pour lesquelles il était appelé à célébrer baptêmes, mariages ou enterrements – je l’ai accompagné à beaucoup plus d’enterrements que d’autres cérémonies, mais auprès de lui, je ne parvenais pas à m’attrister : toutes les célébrations étaient pour moi l’occasion d’une jouissance olfactive, d’un feu d’artifices de fragrances desquelles je me délectais, maîtrisant parfois à grand-peine mes gémissements de plaisir devant les couronnes et les bouquets. Mon maître m’autorisait à rester au pied de l’autel, à la condition expresse que je ne perturbe pas l’office, et étant entendu que je participerais à la remise en état de l’église après la sortie des fidèles. Cela n’était pas une corvée pour moi, loin de là, car j’en profitais pour ramasser les fleurs tombées des bouquets ou des coiffes des mariées, et j’en utilisais les restes pour assembler des compositions qui parfumeraient notre intérieur bien après que les cloches s’étaient tues.
J’ai vécu ainsi six années merveilleuses avec lui. Six années de bonheur, de légèreté, et de partage. Car où qu’il aille, il ne m’a jamais laissé. Moi, l’abandonné, je n’ai plus jamais connu la solitude. Moi, le sot, j’ai appris mille secrets. Moi, l’inutile, je l’ai aidé, dans sa vie quotidienne, soulageant son isolement en même temps qu’il me rendait une raison de vivre.
Auprès de lui et grâce à lui, mon ami, mon maître bien avant Dieu, j’ai trouvé ma place.
En rentrant de notre balade, ce matin, il s’est senti mal, et est allé s’allonger. Il n’a pas bougé de toute la journée.
Je lui ai apporté quelques branches garnies de cerises que j’étais allé casser au fond du jardin, mais il n’y a pas touché.
Ce soir, il a fermé les yeux, et son souffle s’est éteint.
Alors, je suis sorti. Vite, avant que ne tombe le jour.
J’ai parcouru nos chemins, nos sentiers, nos forêts, ramassant partout où je les trouvais ses fleurs préférées, les plus colorées, les plus parfumées, les plus vivantes, et les rapportant à la maison, où je les ai déposées sur son corps. Six fois, sept fois, je ne sais plus vraiment, je suis ressorti, courant à perdre haleine, luttant contre la nuit qui s’annonçait, revenant chargé d’une moisson toujours plus belle dont je recouvrais son corps, ne laissant plus apparaître que son visage, serein, apaisé.
Je crois que j’ai terminé. Je dépose la dernière branche de lilas blanc.
Je m’étends auprès de lui. Je reprends mon souffle.
Maintenant, je vais sucer les tiges de ciguë et les baies de belladone que j’ai rapportées.
Et puis, j’attendrai que l’on vienne nous chercher.
.