– On ferme ! Allez, du balai !
Le cafetier apostrophe une dernière fois l’homme affalé à la table du fond, sa place habituelle. Une fois de plus, il va devoir le mettre dehors, le chasser, le renvoyer à sa vie, une vie de laquelle personne ne tient à savoir davantage que ce qu’on en dit depuis toujours dans le village : celle d’un ivrogne, d’un pauvre type ou des deux à la fois, d’un de ceux à qui la naissance avait pourtant tout offert sur un plateau et qui n’ont pas su en profiter.
L’homme relève péniblement la tête et jette un regard vide au cafetier qui lui indique la sortie d’un signe de tête excédé. Se redressant péniblement, il quitte sa table et se dirige en titubant vers le comptoir, marmonnant à l’adresse du patron :
– Une p’tite dernière, hmm ? T’aurais pas ça, dis, Roger ? Alleeeeez…
– T’as pas entendu ? Tu fous le camp maintenant ! J’en ai plus, de ton jaja ! T’as déjà bu toute ta semaine, figure-toi ! Déjà que celui-là, je le fais venir uniquement pour toi, va pas rêver non plus : j’augmenterai pas mes commandes !
Le patron contourne le zinc et empoigne fermement l’homme qui se laisse conduire jusqu’au seuil du café. Au moment de le pousser dehors, il lui jette un regard méprisant et lance :
– Comme si tu pouvais pas te pochetronner au Ricard, comme tout le monde !
Puis il le jette, sans ménagements, au bas des trois marches qui mènent au Café de la Place. Ce soir encore il va devoir fermer en retard, à cause de cet ivrogne qui n’a jamais demandé autre chose que ses dix bouteilles de chianti hebdomadaires.
Du chianti ! A-t-on jamais vu personne se soûler au chianti ! Mais c’est ainsi : depuis toujours ou presque, seul cet alcool, dans sa bouteille paillée qu’il exige qu’on lui laisse à portée de main, a les faveurs de l’André. Il en consomme plus que de raison, tant au café du village que chez lui, à la ferme, et l’épicier, tout autant que le bistrotier, se sont vus contraints d’en avoir en stock quelle que soit l’heure du jour ou de la nuit. En cas de rupture – cela s’est produit plus d’une fois, et chacun en a gardé un souvenir mémorable –, l’André pique une colère terrible et incontrôlable, et mieux vaut ne pas se trouver sur son chemin ; aussi Monsieur le Maire, en accord avec les deux commerçants (et le docteur ayant fermé les yeux), a-t-il recommandé que nul ne s’oppose à ses pulsions éthyliques, si incongrues fussent-elles. L’André est né ici, et il y mourra sans doute. Nul n’a jamais eu le cœur, le courage ou l’envie de lui signifier qu’il y serait indésirable.
L’André se relève, essuie son bleu d’un revers de la main et se dirige, titubant, vers sa ferme.
Son pas lourd et chancelant l’amène au bas du village. La bâtisse lui apparait au détour du chemin, imposante et sombre, telle une mégère pleine de reproches pour ce propriétaire si peu attentionné. Voilà plus de cinquante ans qu’elle est négligée, abandonnée, réduite à ses murs et à son toit – tout ce qui suffit à l’André pour abriter sa piètre existence. La partie arrière, étables et écuries, n’a jamais été rebâtie après l’incendie, et il se contente de la grande cuisine et de la chambre, la première pour y boire, la seconde pour y cuver.
Poussant la grille qui hurle sur ses gonds, l’André se dirige d’emblée vers la cave, dont l’entrée est envahie de ronces qui lui laissent tout juste le passage. L’ampoule au mur est cassée depuis bien longtemps, mais il n’a pas besoin de lumière ; ses mains savent par cœur l’endroit où elles se refermeront sur son seul et dernier trésor : sa réserve de chianti. Car ce ne sont pas les quelques litres que lui commande l’épicier chaque semaine qui suffiraient à le rassurer : il y a là des caisses entières de bouteilles à l’ancienne, dans leur robe de paille, qu’il a fait venir, des années durant, parcourant les villages et les petits commerces des environs et négociant avec les restaurateurs ; ces jours-là, il restait sobre, soucieux de paraître sous son meilleur jour afin que nul se soupçonne son addiction. Le temps passant et sa réputation s’étendant aux alentours, il lui a fallu aller de plus en plus loin pour trouver un endroit où on ne le connaissait pas. À présent, il n’en a plus la force, mais sa cave est suffisamment pleine pour tenir encore, quelques années, le temps qu’il faudra pour que la mort vienne et l’emporte. Et tant mieux si elle arrive tôt.
L’André saisit une bouteille par le goulot et l’emporte jusqu’à la cuisine. Là, il s’assied, la débouche et boit une rasade de vin au goulot. Il a besoin de cette vague de chaleur qui emporte ses sens, de la force de ce feu qui lui est devenu, au fil des ans, indispensable et sacré. Il a besoin de ce cérémonial invariable – le bouchon ôté, la grande lampée, les yeux fermés, puis, la bouteille reposée, la main qui suit les courbes de la robe de paille, jusqu’à la table sale, et à nouveau une lampée, et les pensées qui s’enflamment, les images qui affluent et qu’il chasse, parce qu’il ne les comprend pas, parce qu’il refuse de les comprendre, la paille de la bouteille et le feu de l’alcool, l’éclat de la robe et la chaleur des sens, la blondeur des cheveux et l’ardeur du regard… Adèle. Adèle qui lui revient, contre son gré, à chaque bouteille, à chaque cuite, à chaque goutte bue de la honte qu’il n’avouera jamais… Adèle !
Elle était arrivée un matin, venue d’un village éloigné ; on lui avait parlé de la place à pourvoir. La ferme était prospère alors, et le père, tout juste veuf, avait besoin d’une fille de ferme pour s’occuper de la maison. André avait dix-sept ans. Elle en avait seize. Le père le destinait à un bel avenir : il reprendrait la ferme, avec ses terres et ses bêtes, et les revenus assurés suffiraient à sa subsistance ; n’étaient-ils pas parmi les gens les plus aisés du village ? André avait commencé à le suivre dans ses journées, supervisant les journaliers, négociant avec les acheteurs, s’assurant de la qualité des récoltes et de la santé des bêtes. Un travail lourd, mais passionnant, qu’il se mit pourtant à négliger du jour où Adèle lui apparut. Sa blondeur, ses yeux de braise, et toute la grâce de son corps juvénile ne lui laissèrent plus de répit. Nuit et jour, il ne pensait qu’à elle. Dès le petit matin, il la guettait au sortir de sa chambrette, et la suivait tout le jour, sans qu’elle s’en aperçût, ou si rarement qu’elle n’en semblait alors que surprise. Adèle était douce, et efficace dans son travail ; le père l’appréciait beaucoup, et ne soupçonnait pas un instant l’obsession qu’elle avait fait naître chez son fils. Celui-ci le déçut bientôt de plus en plus, semblant se désintéresser de la ferme à laquelle il semblait pourtant si attaché ; mais le père mit ce comportement sur le compte de l’adolescence qui lui rendrait bientôt un André responsable et ambitieux.
Toute une saison passa, qui ne laissa aucun répit à la passion du jeune homme. Quand elle s’aggrava, le père, inquiet de voir son enfant dépérir, appela le docteur, qui prescrivit de l’exercice et des vitamines ; rien n’y fit. André allait de plus en plus mal, et personne ne soupçonnait la nature du mal qui le rongeait.
Quand le père mourut, d’un soudain arrêt du cœur, André resta seul à la ferme avec Adèle. Et avec ses démons.
Le poing de l’André se referme sur la bouteille vide, qu’il soulève de la table et projette avec violence contre le mur de la cuisine. Assez ! Assez de ces souvenirs qui le hantent, de ces cauchemars éveillés qui le torturent, de ces remords dévorants dont il paie le prix chaque jour de sa pauvre vie, se tuant à petit feu, offrant au Diable le reste de ses jours comme s’il avait jamais pu expier pour ce qu’il avait fait ce jour-là !… Ce soir-là… Adèle achevait de rentrer les bêtes, et il l’avait attendue au coin de l’étable. L’hiver approchait et les jours étaient courts, la pénombre s’était installée et elle ne l’avait pas vu. Il n’avait rien su dire. Il n’avait pu qu’agir. Que laisser son corps lui dicter ses actes fous – la main qui bâillonne, le bras qui enserre, puis renverse, et immobilise sur la paille, et le ventre qui s’affole, la fièvre qui monte, et la sensation acérée, la certitude brûlante, que jamais plus rien ne sera comme avant, mais que peu importe, qu’une seule chose compte alors : la posséder. L’avoir à lui. L’aimer ! – comme plus jamais il ne l’aimerait.
Quand il avait repris ses esprits, le corps d’Adèle était resté inerte entre ses bras. Les traces rouges autour de son cou l’avaient étonné : il ne se souvenait de rien. C’est dans un état second qu’il alla à la réserve chercher un bidon d’essence, arrosa l’étable puis y mit le feu. Les pompiers alertés par les voisins le trouvèrent debout devant sa ferme en flammes, immobile et muet, incapable dans sa stupeur d’expliquer quoi que ce soit. On sauva une partie de la maison, et personne ne réclama jamais Adèle. Elle n’avait jamais existé.
C’est ce qu’André avait décidé de croire, lorsqu’il tenta de reprendre sa vie, seul désormais face à ses murs calcinés et aux fumerolles de sa mémoire . Il commença à boire, plus que de raison, au bistrot du village où il passait ses journées, et chez lui dès qu’il était rentré. L’héritage suffisait à l’entretenir, chacun le savait bien mais se désolait d’assister au naufrage de celui qui avait un temps été le meilleur parti des alentours. Tous les alcools y passèrent, mais aucun ne semblait convenir à André. Les nuits passées à vomir ne faisaient qu’entretenir sa souffrance. Un soir de beuverie, il aperçut, posée sur une étagère fixée contre le grand miroir du bar, une robe de paille : une bouteille de chianti, lui dit le cafetier, qui lui en servit un verre. André en avala le contenu d’un coup sec puis, fermant les yeux, s’empara de la bouteille et se mit à en dessiner les courbes du plat de la main. Le grain de la paille crissait sous ses doigts tandis que le feu de l’alcool enveloppait sa gorge. Il étouffa un sanglot avant de redemander un verre ; puis un autre. La paille et le feu, les cheveux et les yeux d’Adèle, la naissance de cet amour et la mort qu’il lui avait donnée, tout s’entremêlait dans ses pensées altérées mais seuls ces souvenirs, désormais, habiteraient son esprit : voilà ce à quoi il s’était condamné.
La dernière bouteille roule sous la table, dessinant des méandres à l’encre du vin qui s’écoule encore du goulot. André s’est effondré sur la table, les deux bras pendant le long du corps. Sa tête prête à exploser roule de part et d’autre sous les hallucinations qui l’assaillent. Dans un effort surhumain, il se redresse. Titubant, il sort de la ferme et se dirige vers la grange. La lune est pleine ; ses pas, étrangement, s’assurent. Peut-être, enfin, sait-il maintenant ce qu’il fait.
Dans sa poche, ses doigts se crispent sur la boîte d’allumettes. La paille a moisi, mais elle a bien séché aussi. André traverse la grange et s’immobilise en son centre. Il lève les yeux vers le toit à demi-effondré. Il y a des étoiles. Il sourit.
Cette nuit, une nouvelle fois, la paille et le feu vont s’unir. Et l’emporter, enfin, avec eux.

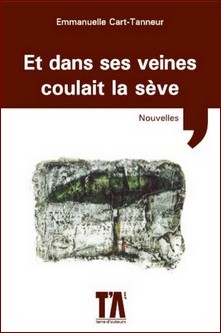

2 réponses à Pourvu qu’on ait l’ivresse